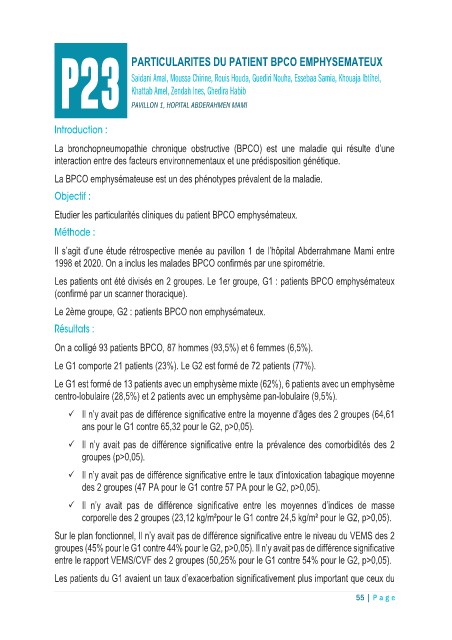Page 60 - Livre électronique du Congrès CNP 2021
P. 60
PARTICULARITES DU PATIENT BPCO EMPHYSEMATEUX
Saidani Amal, Moussa Chirine, Rouis Houda, Guediri Nouha, Essebaa Samia, Khouaja Ibtihel,
Khattab Amel, Zendah Ines, Ghedira Habib
P23 PAVILLON 1, HOPITAL ABDERAHMEN MAMI
Introduction :
La bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) est une maladie qui résulte d’une
interaction entre des facteurs environnementaux et une prédisposition génétique.
La BPCO emphysémateuse est un des phénotypes prévalent de la maladie.
Objectif :
Etudier les particularités cliniques du patient BPCO emphysémateux.
Méthode :
Il s’agit d’une étude rétrospective menée au pavillon 1 de l’hôpital Abderrahmane Mami entre
1998 et 2020. On a inclus les malades BPCO confirmés par une spirométrie.
Les patients ont été divisés en 2 groupes. Le 1er groupe, G1 : patients BPCO emphysémateux
(confirmé par un scanner thoracique).
Le 2ème groupe, G2 : patients BPCO non emphysémateux.
Résultats :
On a colligé 93 patients BPCO, 87 hommes (93,5%) et 6 femmes (6,5%).
Le G1 comporte 21 patients (23%). Le G2 est formé de 72 patients (77%).
Le G1 est formé de 13 patients avec un emphysème mixte (62%), 6 patients avec un emphysème
centro-lobulaire (28,5%) et 2 patients avec un emphysème pan-lobulaire (9,5%).
Il n’y avait pas de différence significative entre la moyenne d’âges des 2 groupes (64,61
ans pour le G1 contre 65,32 pour le G2, p>0,05).
Il n’y avait pas de différence significative entre la prévalence des comorbidités des 2
groupes (p>0,05).
Il n’y avait pas de différence significative entre le taux d’intoxication tabagique moyenne
des 2 groupes (47 PA pour le G1 contre 57 PA pour le G2, p>0,05).
Il n’y avait pas de différence significative entre les moyennes d’indices de masse
corporelle des 2 groupes (23,12 kg/m²pour le G1 contre 24,5 kg/m² pour le G2, p>0,05).
Sur le plan fonctionnel, Il n’y avait pas de différence significative entre le niveau du VEMS des 2
groupes (45% pour le G1 contre 44% pour le G2, p>0,05). Il n’y avait pas de différence significative
entre le rapport VEMS/CVF des 2 groupes (50,25% pour le G1 contre 54% pour le G2, p>0,05).
Les patients du G1 avaient un taux d’exacerbation significativement plus important que ceux du
55 | Pa g e