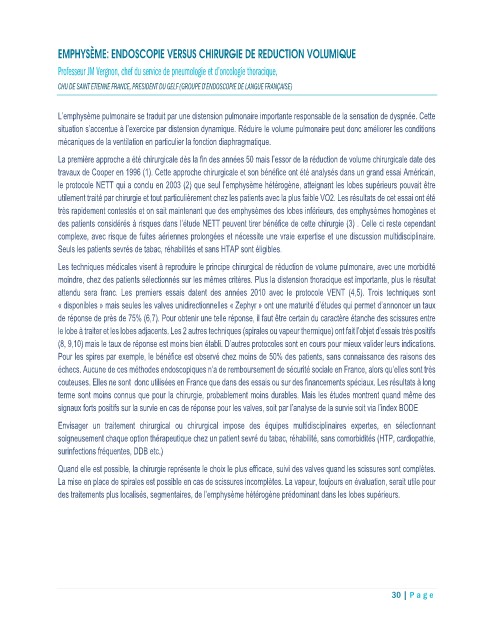Page 34 - Livre électronique du Congrès National de Pneumologie 2018
P. 34
EMPHYSÈME: ENDOSCOPIE VERSUS CHIRURGIE DE REDUCTION VOLUMIQUE
Professeur JM Vergnon, chef du service de pneumologie et d’oncologie thoracique,
CHU DE SAINT ETIENNE FRANCE, PRESIDENT DU GELF (GROUPE D’ENDOSCOPIE DE LANGUE FRANÇAISE)
L’emphysème pulmonaire se traduit par une distension pulmonaire importante responsable de la sensation de dyspnée. Cette
situation s’accentue à l’exercice par distension dynamique. Réduire le volume pulmonaire peut donc améliorer les conditions
mécaniques de la ventilation en particulier la fonction diaphragmatique.
La première approche a été chirurgicale dès la fin des années 50 mais l’essor de la réduction de volume chirurgicale date des
travaux de Cooper en 1996 (1). Cette approche chirurgicale et son bénéfice ont été analysés dans un grand essai Américain,
le protocole NETT qui a conclu en 2003 (2) que seul l’emphysème hétérogène, atteignant les lobes supérieurs pouvait être
utilement traité par chirurgie et tout particulièrement chez les patients avec la plus faible VO2. Les résultats de cet essai ont été
très rapidement contestés et on sait maintenant que des emphysèmes des lobes inférieurs, des emphysèmes homogènes et
des patients considérés à risques dans l’étude NETT peuvent tirer bénéfice de cette chirurgie (3) . Celle ci reste cependant
complexe, avec risque de fuites aériennes prolongées et nécessite une vraie expertise et une discussion multidisciplinaire.
Seuls les patients sevrés de tabac, réhabilités et sans HTAP sont éligibles.
Les techniques médicales visent à reproduire le principe chirurgical de réduction de volume pulmonaire, avec une morbidité
moindre, chez des patients sélectionnés sur les mêmes critères. Plus la distension thoracique est importante, plus le résultat
attendu sera franc. Les premiers essais datent des années 2010 avec le protocole VENT (4,5). Trois techniques sont
« disponibles » mais seules les valves unidirectionnelles « Zephyr » ont une maturité d’études qui permet d’annoncer un taux
de réponse de près de 75% (6,7). Pour obtenir une telle réponse, il faut être certain du caractère étanche des scissures entre
le lobe à traiter et les lobes adjacents. Les 2 autres techniques (spirales ou vapeur thermique) ont fait l’objet d’essais très positifs
(8, 9,10) mais le taux de réponse est moins bien établi. D’autres protocoles sont en cours pour mieux valider leurs indications.
Pour les spires par exemple, le bénéfice est observé chez moins de 50% des patients, sans connaissance des raisons des
échecs. Aucune de ces méthodes endoscopiques n’a de remboursement de sécurité sociale en France, alors qu’elles sont très
couteuses. Elles ne sont donc utilisées en France que dans des essais ou sur des financements spéciaux. Les résultats à long
terme sont moins connus que pour la chirurgie, probablement moins durables. Mais les études montrent quand même des
signaux forts positifs sur la survie en cas de réponse pour les valves, soit par l’analyse de la survie soit via l’index BODE
Envisager un traitement chirurgical ou chirurgical impose des équipes multidisciplinaires expertes, en sélectionnant
soigneusement chaque option thérapeutique chez un patient sevré du tabac, réhabilité, sans comorbidités (HTP, cardiopathie,
surinfections fréquentes, DDB etc.)
Quand elle est possible, la chirurgie représente le choix le plus efficace, suivi des valves quand les scissures sont complètes.
La mise en place de spirales est possible en cas de scissures incomplètes. La vapeur, toujours en évaluation, serait utile pour
des traitements plus localisés, segmentaires, de l’emphysème hétérogène prédominant dans les lobes supérieurs.
30 | Pa g e