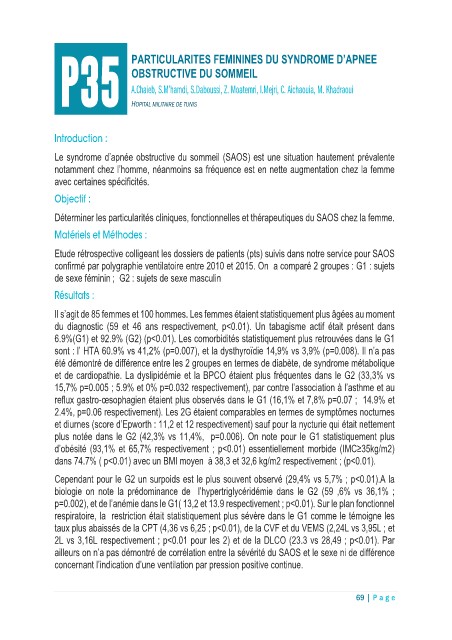Page 74 - Livre électronique du Congrès CNP 2021
P. 74
PARTICULARITES FEMININES DU SYNDROME D’APNEE
OBSTRUCTIVE DU SOMMEIL
A.Chaieb, S.M’hamdi, S.Daboussi, Z. Moatemri, I.Mejri, C. Aichaouia, M. Khadraoui
P35 HOPITAL MILITAIRE DE TUNIS
Introduction :
Le syndrome d’apnée obstructive du sommeil (SAOS) est une situation hautement prévalente
notamment chez l’homme, néanmoins sa fréquence est en nette augmentation chez la femme
avec certaines spécificités.
Objectif :
Déterminer les particularités cliniques, fonctionnelles et thérapeutiques du SAOS chez la femme.
Matériels et Méthodes :
Etude rétrospective colligeant les dossiers de patients (pts) suivis dans notre service pour SAOS
confirmé par polygraphie ventilatoire entre 2010 et 2015. On a comparé 2 groupes : G1 : sujets
de sexe féminin ; G2 : sujets de sexe masculin
Résultats :
Il s’agit de 85 femmes et 100 hommes. Les femmes étaient statistiquement plus âgées au moment
du diagnostic (59 et 46 ans respectivement, p<0.01). Un tabagisme actif était présent dans
6.9%(G1) et 92.9% (G2) (p<0.01). Les comorbidités statistiquement plus retrouvées dans le G1
sont : l’ HTA 60.9% vs 41,2% (p=0.007), et la dysthyroïdie 14,9% vs 3,9% (p=0.008). Il n’a pas
été démontré de différence entre les 2 groupes en termes de diabète, de syndrome métabolique
et de cardiopathie. La dyslipidémie et la BPCO étaient plus fréquentes dans le G2 (33,3% vs
15,7% p=0.005 ; 5.9% et 0% p=0.032 respectivement), par contre l’association à l’asthme et au
reflux gastro-œsophagien étaient plus observés dans le G1 (16,1% et 7,8% p=0.07 ; 14.9% et
2.4%, p=0.06 respectivement). Les 2G étaient comparables en termes de symptômes nocturnes
et diurnes (score d’Epworth : 11,2 et 12 respectivement) sauf pour la nycturie qui était nettement
plus notée dans le G2 (42,3% vs 11,4%, p=0.006). On note pour le G1 statistiquement plus
d’obésité (93,1% et 65,7% respectivement ; p<0.01) essentiellement morbide (IMC≥35kg/m2)
dans 74.7% ( p<0.01) avec un BMI moyen à 38,3 et 32,6 kg/m2 respectivement ; (p<0.01).
Cependant pour le G2 un surpoids est le plus souvent observé (29,4% vs 5,7% ; p<0.01).A la
biologie on note la prédominance de l’hypertriglycéridémie dans le G2 (59 ,6% vs 36,1% ;
p=0.002), et de l’anémie dans le G1( 13,2 et 13.9 respectivement ; p<0.01). Sur le plan fonctionnel
respiratoire, la restriction était statistiquement plus sévère dans le G1 comme le témoigne les
taux plus abaissés de la CPT (4,36 vs 6,25 ; p<0.01), de la CVF et du VEMS (2,24L vs 3,95L ; et
2L vs 3,16L respectivement ; p<0.01 pour les 2) et de la DLCO (23.3 vs 28,49 ; p<0.01). Par
ailleurs on n’a pas démontré de corrélation entre la sévérité du SAOS et le sexe ni de différence
concernant l’indication d’une ventilation par pression positive continue.
69 | Pa g e