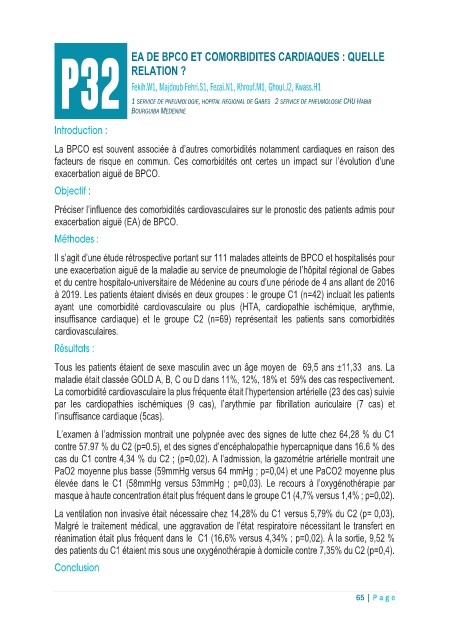Page 70 - Livre électronique du Congrès CNP 2021
P. 70
P32 EA DE BPCO ET COMORBIDITES CARDIAQUES : QUELLE
RELATION ?
Fekih.W1, Majdoub Fehri.S1, Fezai.N1, Khrouf.M1, Ghoul.J2, Kwass.H1
1 SERVICE DE PNEUMOLOGIE, HOPITAL REGIONAL DE GABES 2 SERVICE DE PNEUMOLOGIE CHU HABIB
BOURGUIBA MEDENINE
Introduction :
La BPCO est souvent associée à d’autres comorbidités notamment cardiaques en raison des
facteurs de risque en commun. Ces comorbidités ont certes un impact sur l’évolution d’une
exacerbation aiguë de BPCO.
Objectif :
Préciser l’influence des comorbidités cardiovasculaires sur le pronostic des patients admis pour
exacerbation aiguë (EA) de BPCO.
Méthodes :
Il s’agit d’une étude rétrospective portant sur 111 malades atteints de BPCO et hospitalisés pour
une exacerbation aiguë de la maladie au service de pneumologie de l’hôpital régional de Gabes
et du centre hospitalo-universitaire de Médenine au cours d’une période de 4 ans allant de 2016
à 2019. Les patients étaient divisés en deux groupes : le groupe C1 (n=42) incluait les patients
ayant une comorbidité cardiovasculaire ou plus (HTA, cardiopathie ischémique, arythmie,
insuffisance cardiaque) et le groupe C2 (n=69) représentait les patients sans comorbidités
cardiovasculaires.
Résultats :
Tous les patients étaient de sexe masculin avec un âge moyen de 69,5 ans ±11,33 ans. La
maladie était classée GOLD A, B, C ou D dans 11%, 12%, 18% et 59% des cas respectivement.
La comorbidité cardiovasculaire la plus fréquente était l’hypertension artérielle (23 des cas) suivie
par les cardiopathies ischémiques (9 cas), l’arythmie par fibrillation auriculaire (7 cas) et
l’insuffisance cardiaque (5cas).
L’examen à l’admission montrait une polypnée avec des signes de lutte chez 64,28 % du C1
contre 57.97 % du C2 (p=0.5), et des signes d’encéphalopathie hypercapnique dans 16.6 % des
cas du C1 contre 4,34 % du C2 ; (p=0,02). A l’admission, la gazométrie artérielle montrait une
PaO2 moyenne plus basse (59mmHg versus 64 mmHg ; p=0,04) et une PaCO2 moyenne plus
élevée dans le C1 (58mmHg versus 53mmHg ; p=0,03). Le recours à l’oxygénothérapie par
masque à haute concentration était plus fréquent dans le groupe C1 (4,7% versus 1,4% ; p=0,02).
La ventilation non invasive était nécessaire chez 14,28% du C1 versus 5,79% du C2 (p= 0,03).
Malgré le traitement médical, une aggravation de l’état respiratoire nécessitant le transfert en
réanimation était plus fréquent dans le C1 (16,6% versus 4,34% ; p=0,02). À la sortie, 9,52 %
des patients du C1 étaient mis sous une oxygénothérapie à domicile contre 7,35% du C2 (p=0,4).
Conclusion
65 | Pa g e